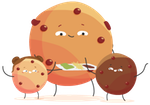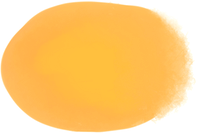Jean Rochard : Comment la musique arrive-t-elle à toi ?
Didier Levallet : Je suis né dans l’Yonne vers Auxerre d’une famille parisienne en juillet 44.
La musique a toujours été présente dans mon environnement de façon un peu bourgeoise ; ma mère jouait du piano (Chopin) comme une jeune fille bien élevée ; mon père avait été musicien semi-professionnel mais avait arrêté quand il s’est marié. Mais il avait des disques. Je me souviens de 78 tours de Benny Goodman, Artie Shaw. À 11 ou 12 ans, on m’a offert un disque de Sidney Bechet, Les Oignons et je suis tombé dedans. Ce musicien au milieu des années 50 était la grande star des jeunes en France, un grand musicien par ailleurs. C’est juste avant 56, avant que ne débarque Elvis Presley. J’ai eu un rêve de gosse : devenir clarinettiste de jazz, mais ça n’allait pas plus loin, on ne m’avait pas proposé d’aller à l’école de musique. J’ai commencé à collectionner les disques de Bechet. Il y a eu aussi ce fameux disque Horizons du jazz de la Guilde du jazz offert avec l’électrophone, une vraie ouverture où figuraient deux morceaux de Charlie Parker, un avec Gillespie « Relaxin at Camarillo » et puis Art Tatum, Erroll Garner... La musique de Parker s’avérait plus complexe que celle de Bechet mais à force de réécouter, je suis entré dedans. Je révère toujours autant Sidney Bechet pour son exceptionnelle invention maîtrisée. Parker, ça reste une référence absolue en terme d’improvisation. Je me suis fait offrir une guitare que j’ai gratouillée mais ça n’allait pas beaucoup plus loin. Lorsque j’ai eu 15 ans, nous sommes partis à Lille où je suis resté 8 ans. J’y ai fini mes études secondaires et fait mes études supérieures dans une école de journalisme. J’ai retrouvé le saxophone de mon père et je l’ai fait réparer. J’en ai joué sans prendre de cours, reproduisant les thèmes entendus sur les disques. On a monté un orchestre avec des copains. Je louais une contrebasse pour le bassiste, mais il ne travaillait pas du tout son instrument. J’ai donc pris la contrebasse et ça a duré pendant 2 ans. Vers 18 ans je jouais alternativement du sax ou de la contrebasse suivant les groupes. J’avais été convaincre une patronne de bistrot auprès de la fac de médecine qui avait un sous-sol aménagé en discothèque. Je lui ai proposé d’y jouer sans être payé mais avec consommations pour les musiciens. Je jouais toute la soirée, une partie avec mon quartet au saxophone alto et l’autre en trio avec un pianiste et un batteur.
JR : Le répertoire à l’époque ?
DL : J’étais fan de Jackie McLean, Phil Woods. J’avais les premiers Blue Note distribués en France, la musique de The Connection, en gros beaucoup de hard bop.
JR : Donc, c’était le début des années 60...
DL : Juste après le passage des Jazz Messengers à Paris. Quant à nous, nous jouions sans
partitions (il n’y en avait pas). Des copains plus costauds que nous pouvaient relever des accords et nous filaient des grilles. Les thèmes, je les apprenais à l’oreille. J’ai joué un peu plus de deux ans dans ce club qui s’appelait le Kaducé tout en étant étudiant. C’est là que Michel Grailler, qui suivait les cours d’une école d’ingénieur pas loin de la mienne, a débarqué un soir et joué du jazz pour la première fois de sa vie. Il est tombé dans la marmite et s’est mis à tout écouter comme un fou. André Hartman, un batteur lillois qui jouait avec Stéphane Grappelli, m’a dit que j’avais plus d’étoffe sur la contrebasse que sur le saxophone. Et comme on trouve toujours du travail en tant que contrebassiste… J’ai commencé à accompagner mes potes étudiants qui chantaient et rêvaient d’avoir, comme Brassens, un Pierre Nicolas derrière eux. J’ai joué sur le premier disque de Jacques Bertin en 1967 pour La Boîte à Musique, début d’une longue complicité. Lors des Jam Sessions étudiantes, le jazz était plus ou moins toléré. Les étudiants, s’en foutaient du jazz, comme toujours. J’accompagnais ces braves gens chantant et c’est là qu’a déboulé de Belgique Julos Beaucarne. Nous avons sympathisé. Les week-ends, j’allais le rejoindre en train (teuf teuf) avec ma contrebasse à Bruxelles et lui venait me chercher en 2 CV. On partait en Wallonie jouer dans les bistrots. Ça ne gagnait pas lourd.
[image|135|droite] JR : Mais ça se profile alors comme un métier ?
DL : Le tournant professionnel est venu par les variétés. Le journal La Voix du Nord avait un car podium où il produisait des spectacles gratuits - de propagande - y compris une tournée des plages de la Mer du Nord l’été. Ils ont engagé pour quelques galas un couple de chanteurs qui venait de remporter le palmarès des chansons de Guy Lux : Line et Willy. Le type de La Voix du Nord me connaissait et m’a mis sur le coup. J’ai tourné par la suite 7-8 ans avec eux. Ces gens en début de carrière, boostés par l’émission de Guy Lux, n’avaient pas encore de musiciens attitrés. Je terminais mes études. Comme j’étais sursitaire, l’armée ne m’a pas appelé tout de suite, j’ai même cru qu’elle m’avait oublié. J’ai pris une pièce chez des gens à Paris, et tous les week-ends, je partais sur les routes avec eux. Il y avait des grandes tournées de variété sous chapiteau ou dans des grandes salles de villes de province. Ils étaient les vedettes américaines, fin de première partie, entracte et après la vedette. En 1968, Nana Mouskouri était au programme, d’autres fois Enrico Macias, Moustaki. J’ai gagné ma vie ainsi. Je suivais encore mes cours au conservatoire de Lille. J’y étais entré quasiment par effraction. Un jour avec un copain en classe d’alto au conservatoire, on avait envie de jouer mais il n’y avait pas de salle de libre et il me dit « il y a la salle des contrebasses au conservatoire, on va aller là, il y a un piano et on va jouer. » On rentre en douce et on se met à jouer. Le directeur du conservatoire se pointe. « Qu’est-ce que vous faites là ? »
« Je n’ai rien contre le jazz, mais vous n’êtes pas élèves, vous n’êtes pas inscrits ». On lui a répondu : « On va s’inscrire, on va s’inscrire ». J’ai suivi les cours de contrebasse pendant trois à quatre ans y compris quand j’étais à Paris. Je revenais prendre mes cours à Lille même si entre- temps, je m’étais inscrit dans d’autres cours sur Paris avec un contrebassiste soliste de l’Orchestre de Paris qui enseignait, comme beaucoup de musiciens classiques, dans plusieurs conservatoires d’arrondissement. Je n’ai pas poussé mes études très loin.
JR : On est en 1964 là ?
DL : Oui. Ce batteur lillois jouait à l’Hilton à Paris avec Grappelli, il y avait Marc Hemmeler au Piano, Pierre Sim à la contrebasse. Très bon musicien André Hatman, mais assez fainéant. Après mes études universitaires, en 1966/67, je m’installe donc à Paris prétextant travailler avec les chanteurs et je l’appelle : « Est-ce que tu connais des gens qui chercheraient un contrebassiste ? ». Il m’a donné quelques adresses. Une a mordu. Je me suis retrouvé avec des jeunes musiciens qui revenaient d’une saison dans un club de vacances, et dont le contrebassiste avait décidé de bouder. Ils jouaient au Chat qui Pêche, ce qui était pour moi le temple absolu du jazz moderne, j’étais très impressionné. Avec le batteur, on s’est trouvé embauché par la vedette suivante, Hal Singer. Un soir, Roland Kirk débarque au Chat qui Pêche. Il devait jouer dans un club de la rue Saint-Séverin, La Grande Séverine, qui avait fermé au moment où lui était arrivé pour y jouer ; Maurice Cullaz le baladait dans les clubs. Il a joué « Summertime » sur un tempo d’enfer. Georges Arvanitas était venu avec lui et avait pris la place du pianiste. De toutes façons Arvanitas assurait tout. Je me suis accroché aux branches et ça a été rude. J’ai continué à jouer avec Hal Singer pendant un certain temps. Entre-temps, je fréquentais le Gill’s club. J’y ai joué plusieurs semaines avec Mal Waldron. J’ai fait petit à petit mon trou dans le milieu du jazz où, il faut bien le dire, à cette époque-là en 66, 67, 68, il n’y avait pas 10 bassistes qui débarquaient chaque semaine, donc moi j’étais le petit nouveau. Il y avait à tout casser 200 musiciens qui se revendiquaient de cette musique. On se connaissait tous. On se refilait les affaires. Les musiciens de jazz en France étaient tous à Paris. Du moins le pensait-on. Ce même bassiste qui avait déserté l’orchestre avec lequel j’ai commencé faisait partie du big band de Claude Cagnasso. Ils avaient trouvé une combine pour faire un disque pour les disques Véga. Michel Grailler, Jacques Bolognesi, Alain Hatot étaient dans le coup.
Évidemment, il n’y avait pas d’argent pour payer les musiciens (mais ils étaient d’accord) et, une fois au studio, le bassiste a piqué sa crise. Hatot m’a appelé. Je suis entré dans l’orchestre de Cagnasso au moment de faire le disque (1). Mon premier disque de jazz. Les précédents étaient avec des chanteurs comme Bertin et Beaucarne.
JR : Le journalisme t'a-t-il complètement quitté lorsque tu as opté pour la musique ? Tu sembles avoir gardé un rapport très proche à l'écriture (manifesté dans des articles pour la presse ou d'autres publications)
DL : Durant ces premières années, je n’ai jamais décidé que je renonçais définitivement à ce métier : à cette époque de plein emploi, je savais que ma formation me permettrait de trouver du travail quand je le voudrais, si la musique ne me convenait plus (ou plutôt, si je ne lui convenais plus). D’autre part, il me semble intéressant de tenter d’avoir une parole articulée sur son art. Dans les premiers temps, j’ai donné un coup de main à Jazz Hot, puis ai collaboré au fil du temps à diverses publications : Jazz Magazine, Jazzman, Les Cahiers du Jazz, Politis… Avec Denis-Constant Martin, nous avons écrit un livre sur Mingus.
JR : Mai 1968, ça a été quelque chose qui a compté pour toi ?
DL : J’ai un souvenir particulier personnel de mai 1968, mais je dois préciser que j’étais sous les drapeaux. Je sortais de l’école de journalisme et un de mes condisciples qui avait eu, via Europe 1, un poste au service de presse du ministère de l’air place Balard, m’a proposé de lui succéder. C’était Bernard Langlois. Je n’ai pas lancé de pavés, mais j’ai assisté à des débats à l’Odéon. Le free jazz me titillait. J’avais acheté Mama Too Tight d’Archie Shepp, Expression de Coltrane, le disque Free Jazz de François Tusques. Jean-François Jenny-Clark était mon mentor. Je prenais avec lui des leçons de contrebasse, qu’il ne m’a jamais fait payer. Il jouait (du free) au Requin Chagrin, place de la Contrescarpe, avec Bernard Vitet, Jacques Thollot et Barney Wilen. Un soir il m’a dit « Tiens, viens faire un tour » et il m’a lâché dans la nature en me disant « vas-y joue ! ». J’étais bien embarrassé car je ne comprenais pas comment cette musique marchait. Donc j’ai fait du tempo. Vitet m’a fait la gueule. Plus tard, JF m’a envoyé au pied levé le remplacer au Chat qui pêche avec Aldo Romano qui disait « Mais quand est-ce qu’il revient JF ? ». J’étais aussi en relation avec le batteur Jean Guérin qui avait fait un disque pour Futura. Je connaissais bien Teddy Lasry qui à l’époque jouait de la flûte dans Le Songe d’une nuit d’été de la jeune compagnie Le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine. Avec eux deux et Michel Grailler qui était prêt à tout, je ne sais plus trop par quel biais, on se retrouve à jouer notre free jazz dans l’amphi de la fac de droit à Assas qui était à l’époque tenue par les gauchistes. Ils devaient projeter Le petit soldat de Godard. Nous jouions avant, le film avait du retard. Un des organisateurs a dit : « Les camarades musiciens veulent bien jouer encore ». Dans la salle les gens criaient « non ! ».
J’étais très impressionnable, très romantique. Cet élan de générosité dans les réunions à l’Odéon me parlait au cœur. Je pouvais vouloir y croire même si… ça m’a quand même frappé, j’étais issu d’une famille conservatrice et j’ai définitivement viré ma cuti. Un effet de réflexion, une révolte quand même qui a poussé mon analyse des choses. La question politique m’a toujours intéressée. Je m’interrogeais sur ce qu’on fait là, à quoi on sert…
[image|134|gauche]
JR : Jouant en même temps avec des chanteurs à textes et en même temps avec des musiciens de jazz, qu’est-ce qui te semblait le plus en phase avec ce qui se passait politiquement ?
DL : Spontanément, c’est plutôt les chanteurs parce qu’il y a des textes et que ça dit des choses ; c’est tout le problème de la musique, on connaît ça. Il y a quelques semaines, je me suis replongé dans l’activité du groupe Perception qui a existé de 70 à 77. On faisait une musique free post Coltrane, si on veut, qui aurait du mal à se faire entendre aujourd’hui et qui avait réellement un public. On a fait des dizaines de concerts par le circuit des MJC et des fêtes politiques : la fête de l’Humanité, celle de Lutte ouvrière mais aussi surtout la fête du PSU. Tous ces gens-là étaient un peu dans la même mouvance biologique, le militantisme culturel, peuple de gauche en ayant ras-le-bol d’être gouverné par la droite depuis tant et tant d’années. Curieusement, ce tissu s’est défait quand la gauche a gagné les élections. Bertin avait toujours un discours plus ou moins politisé : le Chili, les Lip à Besançon étaient au cœur de son propos. Notre discours était moins explicite. Je te dirai que concernant la conscience politique des choses, entre Yochk’o Seffer, Siegfried Kessler, Jean-My Truong, je ne sais pas où elle était. Par contre, c’est le public qui se reconnaissait en nous. Nous étions réellement portés par un mouvement qui voulait casser les meubles et ce qu’on faisait en musique correspondait à cela, consciemment ou non. On n’avait pas besoin de mettre des étiquettes dessus. C’était en phase.
JR : Perception est ton premier projet ?
DL : Avec Siegfried Kessler, on accompagnait Johnny Griffin et Kenny Clarke dans les maisons de la culture aux quatre coins de la France et aussi Slide Hampton avec qui j’ai joué au Chat qui pêche. Ça c’était le quotidien des musiciens freelance. J’avais envie d’aller dans cette autre mouvance. Les tentatives de 1968 en groupe étaient plus ou moins abouties ou stables. Il nous manquait sans doute un élément fédérateur pour que cela fonctionne vraiment. Mais j’avais toujours en tête d’essayer de faire cela. Je jouais beaucoup au Gill’s qui était un club désargenté. On partageait la recette à la sortie avec les Terronès. Y compris Hank Mobley et Mal Waldron. J’ai joué un mois avec Hank Mobley. Je le ramenais dans ma 4L et il disait « Mais pourquoi Johnny Griffin, il s’en sort très bien ici et moi j’y arrive pas ! ». Gérard Terronès me faisait confiance. Je lui dis « j’ai envie de monter un groupe » et il me répond : « D’accord je te donne trois soirs au mois de juillet » (1970). J’avais entendu Jean-My Truong avec Joachim Kühn au Gills et trouvais que sa rage de jouer était intéressante. Mon idée, si j’en avais une précise, c’était plutôt d’aller dans le sens « harmolodique », pour dire vite... Je pensais à Rollins avec Don Cherry, plus qu’à Coltrane. J’aimais bien Alain Hatot, très rollinsien, à qui j’ai proposé l’affaire. Mais cette musique-là, il n’en avait strictement rien à foutre. Il est venu le premier soir et il m’a dit qu’il préférait rester chez lui ensuite car il partait en tournée avec Gilbert Bécaud en Russie. En désespoir de cause j’ai appelé Jeff Seffer (2) que j’avais rencontré chez Cagnasso. Je ne le connaissais pas très bien. Il m’a répondu qu’il pouvait le vendredi mais pas le samedi car il avait invité des copains à dîner. Pour remplir le contrat, j’ai appelé Siegfried pour le samedi. Le troisième soir, il y a eu un miracle : Siegfried était en retard et c’est Yochk’o Seffer qui débarque. Il voulait jouer, et on a commencé et Siegfried est arrivé. Ça aurait été dans l’autre sens, cela n’aurait probablement pas marché. On jouait free. Il a allumé le piano électrique, il a foncé dedans et immédiatement ça y était. Il y avait une complémentarité. Siegfried, formidable musicien, avait une oreille harmonique infaillible. Il plaçait des accords là où on ne savait même pas ce que c’était, un sens de l’harmonie moderne, une connaissance étonnante de la musique classique du 20ème siècle. Il y a eu une alchimie, je m’en suis rendu compte immédiatement. Ça faisait 3 jours que je me posais des questions à propos de la note qu’il fallait jouer et là je ne m’en posais plus aucune. Le groupe Perception a démarré ce jour-là, à la seconde où il a allumé le piano. Extraordinaire mais c’est comme cela.
[image|136|droite]
JR : C’est toi qui a trouvé le nom du groupe ?
DL : Oui j’avais trouvé un premier nom alambiqué et un peu prétentieux : « definit perception ensemble » et en fait on a tout viré et on a gardé Perception. Moi je planais à 300 mètres d’altitude en rentrant chez moi. J’ai agité mon téléphone tout l’été pour entretenir le moral des troupes en disant « on a un groupe, il faut absolument qu’on fasse quelque chose ». Le deuxième concert eut lieu au Centre Américain de la rue du Dragon. C’était très drôle parce que j’avais été invité chez le conseiller culturel de l’ambassade des Etats-Unis place de la Concorde. Il revenait des obsèques de Samson François et il m’a présenté à un claveciniste baroque. L’idée c’était de partager l’affiche. J’ai proposé de finir par une improvisation collective. Le claveciniste baroque s’est fait massacrer. Avec Truong et Yochk’o, il n’a pas pu en placer une, on ne l’entendait plus : Il s’appelait William Christie. Je me suis beaucoup démené. J’ai joué le chef de bande et le commercial de l’affaire pour jouer ici et là et on a commencé une très jolie carrière, aujourd’hui je ne sais pas comment on ferait. On était porté par l’époque. Mino Cinelu, puis Jacques Thollot ont joué dans le groupe à la fin.
JR : Il y a eu la création de L’ADMI (Association pour le développement de la musique improvisée). C’est important !
DL : C’est important symboliquement. L’ADMI, c’est Châteauvallon été 72, l’année Portal. Discussion avec Jean-Louis Méchali en coulisse au bar des pros : « Ah si on faisait quelque chose les musiciens tous ensemble ? ». À la rentrée, on a regroupé un certain nombre de gens et on a créé cette association pour le développement de la musique improvisée qui était un peu un manifeste d’une génération et d’une certaine esthétique musicale, y compris des gens plus âgés qui ont souhaité accompagner le mouvement. Je me souviens des Concerts manifestes de démarrage à Normal Sup. Barney Wilen, Christian Vander, sont venus jouer. On a acquis une certaine crédibilité en tant que mouvement. Daniel Humair nous a ouvert le musé d’Art Moderne pour deux concerts dont un avec Raymond Boni et Perception. Nous avons mis nos forces en commun pour louer un local de répétition dans le Marais. L’association a permis des sorties de disques dont le deuxième de Perception en janvier 1971 (3). Le premier disque de Perception étant un Futura.
JR : Il y a eu 3 disques !
DL : Oui et le 3ème disque c’est le 1er disque du Free jazz workshop (plus tard : Workshop de Lyon), Inter fréquence. En 1971, des musiciens de Lyon m’avaient appelé, ils avaient besoin d’un bassiste. Jean Méreu m’a dit : « on a un bon batteur, François Tusques l’apprécie ». Il essayait de me convaincre car je ne les connaissais pas. Ils avaient 3 concerts à Aix-en-Provence. Bolcato avait quitté le groupe provisoirement. J’ai alors fait la connaissance de Jean Méreu, Maurice Merle et Christian Rollet. Il y avait une communauté de destin entre les musiciens de cette génération-là.
JR : Est-ce qu’il y avait une influence de ce qui se passait en Allemagne, en Angleterre ou en Hollande ?
DL : Terronès importait les disques INCUS… Le festival de Gand nous avait invités. Politiquement, on était dans cette époque-là : prendre son destin en main, faire la musique qu’on voulait faire quand on le voulait et sortir un disque éventuellement. Le disque de Perception, je l’ai financé de A à Z. J’avais acheté 500 pochettes blanches : on a fait des pochettes à la main avec Yochk’o… Inter fréquence, c’était pareil avec une lithogravure. Des objets sympas, artisanaux.
L’ADMI a duré environ deux ans. J’ai écrit un article dans Jazz magazine : « Raisons des leçons d’un échec ». Je poussais la réflexion sur la position sociale, politique au sens large du musicien dans la société. Je me référais beaucoup au bouquin d’Eric Sprogis Libérez la musique, un discours assez PSU sur le positionnement du musicien dans la société. Ah Le mot « artiste » ! Maintenant j’ai plus de facilité à l’assumer depuis que j’ai travaillé 10 ans dans une Scène nationale. Il y a des musiciens, des comédiens, des danseurs qui ne sont pas des vedettes et qui donnent beaucoup à leur métier. C’est un mot que j’ai revalorisé, mais à l’époque c’est un mot qui m’énervait. Cette vision bourgeoise de l’Artiste. Oh lui, il est à gauche, et bien oui : c’est un artiste.
JR : Pourquoi L’ADMI s’est arrêtée ?
DL : Parce que les énergies se dispersent, la gestion de la cave… Un très beau lieu avec des fresques qui dataient de la révolution, pas très pratique. C’est devenu un resto au coin de la rue du roi de Sicile. Nous étions trop verts, pas assez structurés. 25 ans plus tard on aurait peut-être eu une subvention du Ministère pour le fonctionnement ! Ha ! ha !
JR : Des années plus tard (années 90), tu as fait partie d’un autre collectif : Zhivaro ?
DL : Oui ça a duré 6-7 ans, mais ce n’est pas comparable. Zhivaro a été initié par un garçon qui avait été programmateur au jazz club de Dunkerque et qui, arrivant à Paris, dit « moi j’ai envie de faire une super agence ». Il y avait Henri Texier, Sylvain Kassap, Gérard Marais, Claude Barthélémy et moi (et, un peu plus tard, Jacques Mahieux)… Finalement ça a dévié, et abouti à un collectif d’événements qui ne fonctionnait jamais en tant que tel, mais toujours avec des invités extérieurs. On faisait ce que j’appelais des concerts Liebig ou Royco, c’est-à-dire Iyophilisés. Tu invites Han Bennink, Evan Parker, François Corneloup et des tas d’autres. On a un jour, deux à tout casser pour les répétitions avec un programme et des invités différents à chaque fois, chacun amenant de la musique.
JR : Après Perception, tu vas monter Confluence ?
DL : J’ai monté Confluence en 74. Musicalement il y a des choses qui nous ont fait réfléchir. Un retour à la forme et presque à la chanson entre guillemets assez interrogeant (Return to forever, par exemple). J’étais un peu réticent. Je le suis toujours. Entre-temps, il y avait eu aussi le Libération music Orchestra de Charlie Haden et Escalator over the hill de Carla Bley. Quand même par rapport à Ayler, un retour à l’écriture même si il y a cette confluence justement entre l’écriture et les solos de Barbieri, Don Cherry ou Roswell Rudd. J’avais côtoyé Jean-Charles Capon pendant les tournées de variété avec Moustaki. J’ai rencontré Christian Escoudé. Jean Querlier jouait du hautbois, du cor anglais, de la flûte et ça m’intéressait bien. Confluence, c’est effectivement un lieu de rencontres entre l’improvisation libre mais aussi le jazz qui swingue, des thèmes, des mélodies. L’orchestre a démarré dans une certaine euphorie mais au fond de lui-même Escoudé n’avait pas du tout envie de faire de la musique improvisée.
JR : Dans le disque rouge, c’est Armand Lemal qui joue les percussions.
DL : Oui, c’est cela. Le groupe a duré 6 ans avec 3 disques chez RCA. Il y avait encore de l’argent dans les grandes maisons de disques.
Ce n’est pas qu’ils nous ont couverts d’or. La collection s’appelait Balance. Le jazz à RCA France, c’était Jean-Paul Guiter pour les rééditions. Pour le reste, on était dans un truc avec des directeurs artistiques glandeurs finis, mais bon on a fait ce qu’on a voulu.
JR : Là, tu deviens compositeur
DL : Oui je commence. Dans Perception, il y avait déjà quelques thèmes de moi qui étaient assez squelettiques. Je cherchais mais n’avais pas la plume très développée. Avec Confluence, je m’en donne à cœur joie avec des morceaux qui durent une face entière, des thèmes différents qui s’enchaînent, des suites. Je renforce un peu mon écriture. Je dois dire que mon écriture d’arrangeur et de compositeur aussi, je l’ai affinée en faisant des arrangements pour les chanteurs.
JR : C’est un groupe où tu vas t’affirmer dans quelque chose qui va continuer en tant que chef d’orchestre
DL : Porteur de projet. Perception a été la conjonction non planifiée de quatre tempéraments qui se sont trouvés. Confluence, c’est un goût pour une certaine instrumentation. Il y a une constante dans ma façon de vivre cette musique-là : je ne veux pas séparer les choses. J’aime bien entraîner des gens sur un terrain sur lequel ils ne seraient pas allés d’eux-mêmes. La preuve, Cinélu ou Pifarély. Quand je l’ai connu, il jouait du violon jazz, ou classique ou folk mais pas l’improvisation libre. Ou alors ce big band par exemple où se côtoyaient Roger Guérin, Jean Cohen, Denis Levaillant, Mino Cinelu, Beb Guérin : des juxtapositions de personnalités et de cultures pas évidentes a priori. C’était encore une forme assez ouverte où l’écriture s’effaçait assez vite devant l’improvisation. Au même moment, je monte mon premier quintet avec André Jaume, Jef Sicard, Jean Querlier, tous flûtistes, tous saxophonistes et deux clarinettistes pour un hautboïste ou cor anglais – et avec Mino Cinélu, puis Jean-Claude Montredon à la batterie. Certains ont cru remarquer que l’écriture est plutôt d’inspiration européenne, l’interprétation penchant vers le jazz américain. A l’époque, j’ai un minimum de crédibilité et les organisateurs nous engagent sur mon nom donc il y a des concerts. Et puis arrive en 1978 le Swing string system.
JR : Qui enregistre pour le Label du parti socialiste Uniteledis. Comment ça s’est fait ? Ils avaient publié le concert de Shepp à Massy.
DL : Dirigé par Maurice Sévenot, journaliste à L’ORTF viré en 1968 pour gauchisme et qui s’occupait de la société médiatique du Parti socialiste. Ce n’était certainement pas sa vocation première de publier des disques et encore moins des disques de jazz ce que d’ailleurs ils n’ont pas très bien fait. Je n’ai pas enregistré l’hymne du Parti socialiste, « Changer la vie », ha ! ha ! ça c’était Herbert Pagani. Par contre, on a enregistré l’Internationale avec un cœur de copains chanteurs pour lequel j’avais mobilisé Georges Arvanitas qui joue de l’Harmonium. On était en relation avec Maurice Sévenot à travers Bertin qui n’était pas au parti socialiste mais avait des accointances. L’adjoint de Sévenot était plus branché musique et m’a dit « et si tu faisais un disque qu’avec des cordes ? ». Banco, c’était le moment où Didier Lockwood émergeait. J’avais employé un autre violoniste qui, lui, avait été dans Zao, Jean-Yves Rigaud : ce n’était pas vraiment un jazzeux mais un bon musicien de séance qui avait joué des musiques rythmiques. Il y avait Capon. J’avais rencontré l’autre violoncelliste, Denis Van Hecke, chez Lubat. J’ai été un peu dans l’avant Compagnie Lubat. On avait un concert dans le Cantal en trio avec Bernard Lubat et Escoudé (il y a eu d’ailleurs un disque de ce trio enregistré en Pologne) pendant l’été 76 et Escoudé ne pouvait pas le faire. Et j’ai appelé Jean-Louis Chautemps. La jonction Chautemps Lubat, elle s’est faite là. Après, ils ont commencé leurs concerts au Mouffetard avec Letheule, moi je n’étais pas dans le coup.
[image|133|gauche]
JR : Tu étais intéressé par tout cela ?
DL : Ah, j’avais un peu de mal quand même. Chautemps disant « Avec la compagnie Lubat, maintenant je fume le cigare sur scène ».
Je voyais bien où était le dadaïsme. Lubat est un tel musicien… Donc à l’époque, je fricotais avec Lubat. Je dis les cordes d’accord mais c’est du jazz donc une batterie, Escoudé et Kessler avec son clavinet justement pour rester dans une couleur plus corde qu’un piano. Et je me suis mis au travail et j’ai écrit toute la musique et l’arrangement sur Carla Bley et on a fait ce disque dans la journée. C’est devenu un jalon dans l’histoire des cordes en France. Le projet a duré avec des formations différentes.
JR : Tu reliais ce que tu fais à une sorte de tradition française. Par exemple Michel Warlop ?
DL : Un peu mais je dirais que la tradition française est plutôt dans l’inspiration du compositeur, de la mélodie que dans le souci d’orchestration. Il y a, toutes modestes proportions gardées, une filiation sensible avec quelques grands ancêtres : Satie, Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc. Cette parenté explique peut-être pourquoi le jazz français n’a jamais eu la radicalité de la musique improvisée britannique ou de l’Europe du nord. Il y a d’autres raisons : par exemple l’isolationnisme de la part des Anglais par rapport aux musiciens américains alors que nous avons toujours baigné au milieu des musiciens américains.
JR : Tu figures dans le disque Under Paris Skies de Freddie Redd (1971) avec Freddie Redd dont tu disais aimer The Connection tout à l'heure. Tu as aussi joué comme « sideman » avec Byard Lancaster puis Frank Lowe. As-tu eu envie de t'expatrier à un moment ? Comment vois-tu les rapports complexes du jazz américain et de la scène française ?
DL : Lorsque je suis allé aux Etats-Unis avec Byard Lancaster en 1974, l’idée de m’y
établir a pu me traverser l’esprit. Mais je n’avais aucune base solide là-bas. Difficile d’imaginer de faire le grand saut, d’autant que les mouvements des musiciens européens vers l’Amérique étaient beaucoup plus rares qu’aujourd’hui. L’exemple de Georges Arvanitas – qui avait réussi à jouer très régulièrement là-bas mais en revenait les poches vides – n’était pas encourageant. D’autre part, j’avais un certain nombre de projets sur le feu de ce côté-ci. Quant au rapport jazz américain/français, soyons brefs (sinon…) et considérons deux ou trois choses : pour des raisons culturelles historiques (et économiques) les Etats-Unis produisent et produiront encore des artistes exceptionnels ; il y a une mondialisation du jazz, accompagnée d’un haut niveau d’enseignement, qui fait qu’un langage international bien partagé est à l’œuvre ; des musiciens non américains (peu de Français, il est vrai, même si un certain nombre résident outre-atlantique) ont su se faire une place au sommet : Dave Holland, Joe Zawinul, Jean-Luc Ponty, Miroslav Vitous etc… ; enfin le jazz français a donné des personnalités singulières, irréductibles au seul modèle américain : sans remonter encore à Django et Grappelli, Solal, Portal, Louiss, mais aussi Sclavis, Godard… Il y aurait beaucoup plus à dire, mais la place manquerait.
JR : Tu fais un disque avec In & out en 1981 qui est une maison de disques dans laquelle tu es impliqué.
DL : Maison de disques qu’on a fondée à partir du festival d’Angoulême. In & Out a permis la renaissance du Brothehood of Breath de Chris McGregor dans lequel j’étais impliqué avec Louis Sclavis, François Jeanneau. Il y avait des Anglais, des Français des Sud-Africains, Radu Malfatti aussi. En 80-81 se monte le trio avec Marais et Pifarély qui a aussi beaucoup tourné. Ce trio enregistre à l’ouest de la Grosne chez Jacky Barbier près de Cluny : le disque est sorti chez Open d’Alain Guérini.
JR : C’est important pour toi de faire des disques à ce moment-là.
DL : J’ai un attachement très fort aux disques. J’ai tout appris par le disque. Mes universités, elles sont là ; depuis Bechet jusqu’à Archie Shepp et au-delà. Faire un disque, c’est exister dans la vie musicale, c’est avoir des retours ; à l’époque, c’était beaucoup moins la carte de visite, de démarchage pour les concerts que ça ne l’est devenu maintenant. Le disque du quintet s’est vendu sur plusieurs années et on est arrivé à 2500 exemplaires avec un disque qui un an après sa sortie était susceptible de se vendre encore. Ce qui aujourd’hui est impensable.
JR : Le concert Scoop (4) à Angoulême est un événement. Le ministre de la culture Jack Lang vient au concert et quelques journalistes de Libération.
DL : et l’archevêque aussi… pas du tout les gens qu’il fallait pour assister à ce concert-là.
JR : Lang s’ouvre alors de son goût pour le jazz ou son absence de goût pour le jazz. Ce concert là a-t-il eu une incidence sur ce qui s’est passé ensuite…
DL : La cheville ouvrière de ce qui se passe, c’est Maurice Fleuret, sauf peut-être pour l’ONJ où là il y a la décision du ministre. Jean Carabalona arrive en 1982 à la Direction de la Musique et de la Danse, en charge du jazz, et la politique d’ouverture aux autres musiques date de ce moment-là. A Angoulême, c’est parce que je venais d’y ouvrir la première classe de jazz dans une école nationale de musique. La conférence de Presse de Maurice Fleuret était dans ma salle de cours qui était un petit auditorium. Après ça a essaimé. En 1985, certificat d’aptitude, puis diplôme d’Etat. Toute l’administration de l’enseignement musical se met en branle à ce moment-là. Il y avait une classe de jazz au CNR de Marseille avec Guy Longnon. Je ne sais pas sur quelle définition de poste Longnon a fonctionné. J’ai été titularisé. J’étais l’égal des profs de violon. C’est le début officiel de cette politique. Scoop représente un peu tout ça.
JR : Et les choix s’étaient faits comment ?
DL : Je voulais faire quelque chose autour de Steve Lacy. J’avais fréquenté Marc Charig et Radu Malfatti chez Chris McGrégor. La commande devait être d’avoir un orchestre assez international. L’idée était d’avoir des grands improvisateurs européens et de mettre cela en forme, de bien structurer. Toute la presse snobinarde qui était descendue de Paris est tombée dessus à bras raccourcis en disant « quelle horreur du free jazz ! ». Pour en revenir à Lang : le jazz pourquoi pas, il y a des festivals, ça plaît aux jeunes (croyait-il)… La création de l’ONJ, c’est cela aussi... Sa projection ne va pas beaucoup plus loin que cela par rapport à cette musique mais il y avait un préjugé favorable, un geste envers une musique qui n’avait pas été prise en compte jusque-là, une reconnaissance de valeur.
JR : C’est une époque où il y a plus d’opportunités. Et en même temps, il y a une rupture.
DL : Je crois que c’est à l’automne 1986 qu’il y a le colloque de Mulhouse sur l’enseignement du jazz ou Maurice Fleuret est venu ; George Russel et Ran Blake étaient invités. L’apparition d’un balisage administratif de la qualification crée une autre mentalité. On quitte un certain romantisme. Un élève de conservatoire, c’est quelqu’un qui achète un service et on doit lui donner ce pour quoi il paye.
JR : Quelle était l’urgence de l’enseignement du jazz de cette façon-là.
DL : Ce n’est pas nous qui avons choisi cela. C’est le public qui nous a choisis. Je pense au CIM, Centre d’Information Musicale fondé par Alain Guérini avec l’idée au départ d’un centre de ressources : documentation, discographies etc. et un petit département d’enseignement. Ils ont été dévorés par l’enseignement. Un jour Guérini m’appelle, me dit qu’il y a des réunions sur la vie de musiciens (les droits) et me demande si je peux venir parler. Le sujet ne m’intéressait pas vraiment mais j’y suis allé. Et c’était plein. Et à la sortie, je lui dis « ils sont drôlement sérieux tes élèves ». Il me répond :
« ce sont des élèves de première année qui viennent voir comment le métier se passe ». J’ai raccompagné en voiture une jeune élève du CIM qui m’a dit « Moi je suis en première année de chant jazz et comme il y a du chômage partout, je vais essayer le chant jazz ». Hallucinant.
Quand le Ministère a voulu définir les musiques actuelles et s’y intéresser, le jazz s’est retrouvé dans ce vaste fourre-tout : on a perdu tout ce qu’on avait gagné en 10 ans en terme de reconnaissance, de spécificité y compris économique. La logique économique emporte tout.
JR : Quand L’ONJ se crée, comment tu vis cela ? Tu vas diriger un cycle mais est-ce que c’est quelque chose qui t’intéresse, d’emblée ?
DL : J’ai assisté au jour historique, à la décision chez Lang lors d’un déjeuner. André Francis avait cette idée depuis longtemps avec l’exemple des orchestres des radios allemandes. Fleuret était là, des musiciens (Didier Lockwood, Eric Lelann). Le projet a été vendu à Lang. J’ai toujours pensé que c’était un outil à mettre au service d’un projet musical. Après, on peut gloser sur national jazz machin mais j’ajouterais que d’une façon plus politique, tout le monde sait que ces 800 000 € n’iront nulle part (en tout cas pas au jazz) en cas de suppression de l’orchestre. C’est certain depuis le début.
JR : Et toi, ta participation en tant que chef d’orchestre, directeur musical de l’ONJ, qu’est-ce que ça t’a apporté et en même temps est-ce que ça a apporté aussi un lot de frustrations ?
DL : Ça passe très vite 3 ans, donc j’ai écrit comme un malade. J’ai eu la joie d’aller dans des tas d’endroits vraiment intéressants en particulier à l’étranger (où, tout de même, le fait que la France se soit dotée d’un ONJ génère sans doute l’étonnement, mais fait aussi figure d’exemple). Frustration je sais pas, on est tellement dans la vitesse.
JR : Et quand cela s’arrête ?
DL : Ça s’arrête, voilà ! Moi j’ai choisi une manœuvre de diversion. Après, de toute façon, tu ne fous plus rien. Frustrations, elles sont d’un autre ordre. Je ne comprends pas que les musiciens de la valeur de Chris Biscoe et Harry Beckett n’aient jamais attiré l’attention des commentateurs.
JR : Tu as fait 3 disques ?
DL : Oui dont un avec Jeanne Lee, qui est pour moi le plus réussi.
J’ai été très fier d’avoir été choisi. On a passé des moments formidables. Il y a eu des concerts où l’orchestre a décollé. On a joué en Espagne, en Grèce, Bulgarie, Egypte etc. et puis des moments, dans des théâtres de ville, où tu sens que les gens sont venus par conformisme d’abonnés et que, quand même, tu les emmènes ailleurs.
JR : Mais quand ils rentrent chez eux cet ailleurs-là, qu’est-ce qu’il en reste ?
DL : C’est un éternel problème. Ce sont des questions que je me pose à Cluny. Je ne sais pas ce qui reste dans la tête des gens. Cette consommation festivalière, elle est très volatile. Elle est très liée au lieu, à l’époque.
JR : Lorsque tu évoques ta sortie de l’ONJ, tu fais référence à ton poste de directeur de la Scène Nationale de Montbéliard. C’est un choix important, un choix de faire autre chose que d’être musicien aussi.
DL : J’ai fait une petite erreur d’appréciation, parce que nous autres musiciens nous connaissons tellement mal ces maisons. On n’y séjourne pas. On arrive à 4h, on fait la balance, on va à l’hôtel et on rentre le lendemain, contrairement aux comédiens qui y séjournent longtemps, qui s’installent. Je suis allé voir Sylvie Hubac, directrice de la DMDTS à l’époque : « j’ai fait l’ONJ, c’est la seule institution dont dispose cette musique et comme vous n’allez pas créer des centres nationaux pour le jazz, moi je dirigerais bien une structure ». J’ai toujours eu envie de diriger un établissement où on puisse construire des projets. J’ai confondu en effet une Scène Nationale avec un Centre Dramatique National ou un Centre Chorégraphique National. Je me suis dit : « je vais arriver dans une maison, certes pluridisciplinaire, mais avec une option forte musique, avec ma petite histoire et je vais me poser là-dessus ». Or ce n’est pas cela. Un Centre Dramatique oui : le directeur est obligatoirement un metteur en scène. Un directeur de scène nationale, c’est un programmateur, mais ce n’est pas un artiste par définition. Donc, tu as tout le poids de la maison sur le dos et tu n’es pas attendu pour tes propres productions. Il y a des cas exceptionnels comme Dominique Répécaud à Vandeuvre-les-Nancy, mais il était déjà dans la place avant d’être directeur. C’est le seul. Moi j’étais le seul à être nommé en tant que musicien de jazz, directeur d’une structure. Tu as tellement de trucs qui te tombent sur la tête que tu n’as pas le temps de faire grand chose pour toi. Je savais que j’allais être puni pendant 3-4 ans après l’ONJ, alors… « embarquons-nous là-dedans, ça m’a toujours titillé ». J’ai fait quelques petits trucs mais peu. Au moins, j’ai aidé la musique des autres à vivre. Peut être avais-je besoin de recul. J’ai continué à faire de la musique improvisée. Il y a ce trio avec Günter Sommer et Sylvain Kassap qui existe encore depuis 30 ans. Dans 15 jours, je suis en Allemagne avec eux.
JR : Là, on fait un petit flash back. Il y a une création d’une maison de disques Évidence avec Sylvain ?
DL : Oui Evidence en 1985 avec Roger Fontanel de Nevers. Maintenant le catalogue est en exploitation chez Frémaux.
À un moment où les disques commençaient à plonger du nez, on n’a plus suivi cette affaire-là. Mais ça a quand même duré 15 ans. J’ai toujours eu un intérêt pour la production de disques. Mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire avancer les choses. Prendre son destin en main. On ne nous attend pas, on ne nous doit rien. Quand on parle de politique, du musicien dans la société, j’ai l’impression que c’est un peu faussé : « Comment ! Moi je joue super bien ! On ne m’appelle pas ! » Aujourd’hui on crée un festival et on va frapper à la porte de la DRAC en disant « voilà j’ai créé un festival, il faut me donner des sous. »
JR : Tu as joué aussi avec Jac Berrocal, Dennis Charles et Daunik Lazro.
DL : Oui, ça fait partie des histoires parallèles importantes. Aussi avec Charles Tyler avec qui j’ai fait un joli disque, peu de temps avant sa mort. Je viens de croiser Jacques Coursil et j’aimerais faire quelque chose avec lui. J’ai un projet de quintet pour l’année prochaine. C’est reparti !
1) Claude Gagnasso Big Band : Head Under Legs (Vega)
2) Yochk’o Seffer
3) Perception & Friends (Admi)
4) Scoop avec Steve Lacy, Tony Coe, Radu Malfatti, Marc Charig, Gérard Marais, Gérard Buquet et Tony Oxley (In & out)
Disques de Didier Levallet en vente aux Allumés du Jazz :
Swing Strings System - Eurydice - (EvidenceEVCD06)
Super Swing Strings System - Paris Suite - (Evidence EVCD07)
Swing Strings System - (EvidenceFA449)
Beckett, Levallet - Images of Clarity - (EvidenceEVCD315)
ONJ - Didier Levallet - Séquences - (Evidence EVCD928)
ONJ - Didier Levallet - Deep Feelings - (Evidence FA448)